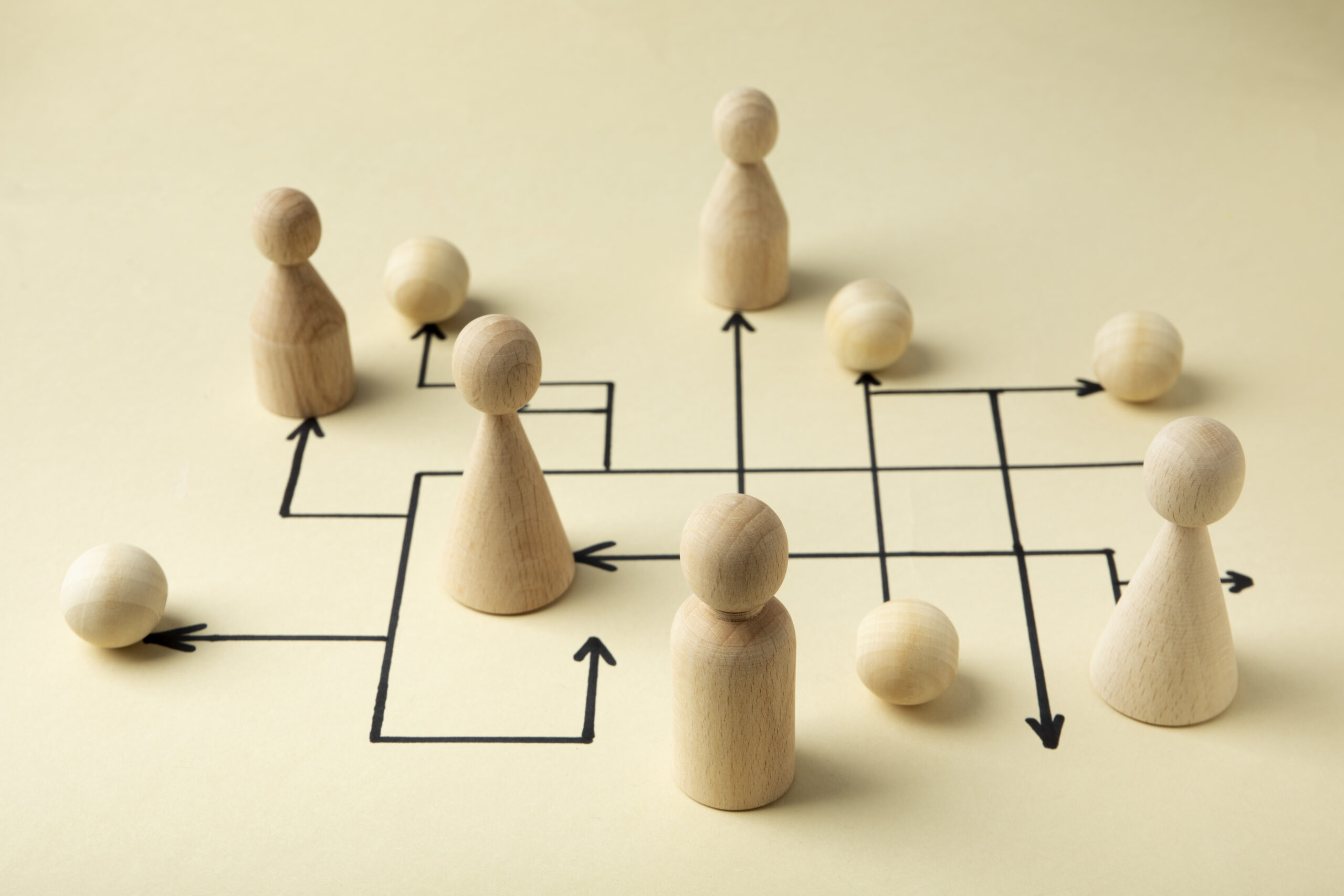
Dans bien des milieux de travail, le changement est encore abordé comme un projet à mener. On planifie, on structure, on gère les étapes. Pourtant, derrière chaque transformation se trouvent des personnes qui doivent la vivre, l’intégrer et, surtout, lui donner un sens.
Un changement réussi repose avant tout sur la capacité collective à s’adapter, à comprendre et à évoluer ensemble. Il ne s’agit pas seulement d’un exercice de planification, mais d’un véritable processus humain.
Chaque transformation génère son lot d’émotions : curiosité, enthousiasme, mais aussi doutes ou appréhensions. Vouloir aller trop vite, c’est risquer de créer de la résistance ou de fragiliser la confiance.
Le changement durable s’installe lorsqu’on tient compte du rythme d’adaptation de chacune et chacun, et qu’on reconnaît les signaux qui émergent en cours de route, qu’il s’agisse de questionnements, d’inquiétudes ou de propositions. Ces signaux sont des indicateurs précieux sur la manière dont le changement est perçu et vécu.
Avancer dans le changement, c’est trouver le bon rythme : celui qui permet de progresser tout en respectant la capacité d’adaptation du collectif. Prendre en compte les besoins des personnes ne signifie pas s’immobiliser, mais marcher ensemble, en ajustant la cadence lorsque c’est nécessaire.
Et surtout, rappeler que le changement prend du temps. Il est normal que certaines situations semblent se désorganiser avant de s’améliorer. Normaliser cette période d’instabilité aide les équipes à rester engagées, même au cœur de la transition.
Pour mieux comprendre ces dynamiques, le modèle de la courbe du deuil d’Élisabeth Kübler-Ross offre un repère utile. Il illustre les différentes phases émotionnelles que les personnes peuvent traverser face à une transition : du déni à l’acceptation, en passant par la résistance et la réorganisation.
Appliqué dans un contexte collectif, il rappelle que l’adaptation ne se décrète pas, elle se soutient par l’écoute, la communication et le respect des rythmes de chacun.e.
Résister à un changement ne signifie pas s’y opposer. Bien souvent, cela traduit un besoin de repères, de clarté ou de reconnaissance. Derrière chaque résistance se cache souvent une peur : la peur de ne pas avoir les compétences nécessaires, la peur de perdre son emploi, son rôle ou son contrôle sur la situation.
Ces résistances, lorsqu’elles sont accueillies et comprises, deviennent des leviers pour ajuster la démarche et renforcer l’adhésion. Les ignorer, au contraire, peut créer de la distance et affaiblir la mobilisation. Reconnaître ces signaux, c’est faire preuve de respect envers les personnes concernées et leur donner un espace d’expression constructif.
Des approches comme l’apprentissage en simple, double et triple boucle, largement mobilisées au Canada par l’Institut Tamarack, montrent comment passer de l’ajustement ponctuel à la remise en question des hypothèses qui structurent nos façons de faire.
En encourageant la réflexion collective, ces pratiques transforment la résistance en occasion d’apprentissage et de co-construction.
Et pour réduire la peur de l’irréversible, il peut être aidant de positionner le changement comme un projet pilote. Se donner six mois pour tester, observer et ajuster permet de se lancer plus facilement, sans la pression d’un engagement “pour toujours”.
Accepter qu’un changement implique des essais, des erreurs et des ajustements, c’est encourager un climat d’apprentissage.
Lorsqu’on permet aux personnes d’expérimenter, de partager et d’apprendre ensemble, on favorise un sentiment de confiance et d’appartenance. Ce climat ouvre la porte à la créativité, au dialogue et à l’engagement, plutôt qu’à la peur ou au contrôle.
Dans cette optique, amorcer le changement sous forme de projet pilote permet de tester certaines pratiques, d’en observer les effets concrets, puis d’y revenir après quelques mois pour ajuster ou bonifier les éléments qui méritent de l’être.
En se donnant le droit d’expérimenter, on transforme le changement en processus évolutif et collectif, plutôt qu’en objectif figé.
Et comme le rappelle souvent la littérature en accompagnement du changement : il est essentiel d’être ferme sur les objectifs, mais souple sur les moyens.
Impliquer les membres de l’équipe dans la recherche de solutions et dans les ajustements à apporter favorise la mobilisation et renforce leur sentiment de compétence et de contribution.
Un changement ne s’impose pas : il se construit dans la durée, avec celles et ceux qui en sont les acteurs et les actrices.
Il prend racine lorsque les personnes comprennent les raisons qui le motivent, participent activement à sa mise en œuvre et se reconnaissent dans le résultat.
Pour qu’un changement soit réellement porteur, il est essentiel d’être ferme sur les objectifs, mais souple sur les moyens.
En impliquant les membres de l’équipe dans la recherche de solutions et dans les façons d’atteindre les résultats visés, on favorise leur appropriation et leur mobilisation.
Chacune et chacun devient ainsi partie prenante du processus, contribuant non seulement à la réussite du projet, mais aussi à la cohérence et à la durabilité de la transformation.
Accorder du temps à l’intégration et à l’appropriation, c’est permettre au changement d’être vécu de manière authentique, cohérente, humaine et durable.
Explorez nos outils gratuits Viaconseil, dont le Questionnaire d’évaluation de la charge de travail et la Grille des phases de préoccupations, conçus pour soutenir vos démarches d’accompagnement humain et participatif.